C'est vers le VIIème siècle que Dunkerque prend naissance sous la
forme d'un établissement de pêche qui se fixe au bord d'une petite crique
abritée par les dunes. Dès lors, les habitants établissent une première chapelle
qui donne bientôt son nom à la localité : l'église des dunes (Duyn Kerke en
flamand).

Très vite, la petite communauté de marins s'organise : un mur
de défense levé en 960 et un hôtel de ville bâti en 1233 attestent que l'essor
urbain démarre véritablement à cette époque. Spécialisé dans la pêche au hareng,
le port se développe lui aussi, en même temps que d'importants aménagements
hydrauliques, assèchements, creusement de canaux interviennent dans l'arrière
pays. C'est à la fin du XIVème siècle que l'activité portuaire découvre une
nouvelle activité : la course.
Ecumant les mers, les Dunkerquois se forgent rapidement une
réputation sur laquelle reposera l'histoire maritime de la cité.

Dunkerque reste cependant une ville sur la défensive qui pour se
protéger, doit maintenir autour d'elle un corset de fortifications. Dunkerque
subit de nombreux sièges bien souvent dévastateurs comme celui de
1558.
Convoité par les grandes puissances, Dunkerque connaît une rare
succession de suzerains : flamands, bourguignons, autrichiens, espagnols,
anglais, français, dont trois se sont succédés en une seule journée, le 25 juin
1658, lors de la fameuse Bataille des Dunes remportée par Turenne.
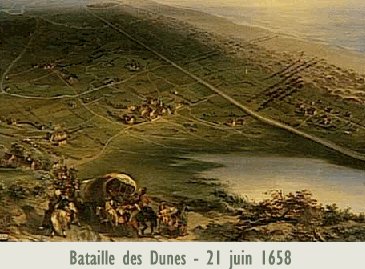
Définitivement française en 1662, la ville connaît alors, grâce à
l'intérêt personnel que lui porte Louis XIV, une transformation radicale qui la
place au rang des grandes villes du royaume. Etendue, embellie, elle demeure le
port d'attache de brillants marins dont le chef de file reste Jean Bart
(1650-1702), le plus célèbre de tous les corsaires français qui s'est illustré
notamment lors de la fameuse Bataille du Texel.
Le XVIIIème siècle se
révèle moins favorable au port flamand à l'exception du développement de la
pêche à la morue en Islande qui lui permettra d'occuper le premier rang national
au XIXème siècle. C'est en 1879 que s'engage une transformation radicale du port
qui lui permet de concurrencer ses voisins et de devenir le principal débouché
du pays sur la Mer du Nord.
Désormais 3ème port de France, Dunkerque est
frappé par les deux conflits mondiaux. Violemment bombardé en 1915 et 1917,
théâtre de l'Opération Dynamo en mai 1940,elle sera largement détruite et
libérée en mai 1945 de l'occupation allemande.


L'Opération Dynamo
Prises en étau par les troupes allemandes, et sous le feu de
leurs avions et de leur artillerie, les forces alliées embarquent à Dunkerque
pour rejoindre l'Angleterre. En neuf jours, 338 226 combattants sont évacués
dans des conditions inouïes. Le 4 juin 1940, l'opération "Dynamo" est achevée ;
le drapeau à croix gammée flotte sur le Beffroi.
Le 20 mai, la situation est désespérée ; deux divisions de panzers
commandées par Heinz Guderian atteignent Abbeville et la mer. La Wehrmacht
parvient ainsi à couper les armées alliées en deux avec, entre les mâchoires de
la tenaille, un million de soldats français, belges et britanniques pris au
piège !
Les chars allemands poursuivent leur progression. Le 24 mai, les
avant-gardes de Guderian établissent six têtes de pont sur l'Aa et atteignent
Bourbourg ; elles ont pratiquement le champ libre lorsqu'un ordre impératif du
général von Rundstedt, confirmé par Hitler, obnubilé par la prise de Paris, les
stoppera net jusqu'au matin du 27. Les Alliés profiteront de l'aubaine. Ils se
regroupent en hérisson pour tenir pied à pied un corridor s'étendant de la
région lilloise à Dunkerque, sur une centaine de kilomètres de profondeur et
trente à quarante de largeur. Pour se dégager, le général français Weygand mise
sur une traditionnelle contre-attaque. Le chef du corps expéditionnaire
britannique, le général Gort, ne partage pas cette option. À moyen terme,
l'évacuation lui semble inévitable. Le cabinet de guerre britannique lui donnera
raison. Le 26 mai, la décision tombe : "En de telles conditions, une seule issue
vous reste : vous frayer un chemin vers l'ouest, où toutes les plages et les
ports situés à l'est de Gravelines seront utilisés pour l'embarquement. La
marine vous fournira une flotte de navires et de petits bateaux, et la Royal Air
Force vous apportera un support total..." L'entreprise est baptisée "opération Dynamo". Son chef, le
vice-amiral Bertram Ramsay, installe son quartier général dans une cave du
château de Douvres, où avait fonctionné, jadis un groupe électrogène. Elle
durera neuf jours pleins : du mardi 26 mai au jeudi 4 juin. Le 29 mai, le
corridor s'est rétréci comme une peau de chagrin : il ne va plus maintenant que,
côté mer, des environs de Dunkerque au petit port belge de Nieuport, aux canaux
de Bergues à Furnes et de Furnes à Nieuport, côté terre. La noria des "little ships"
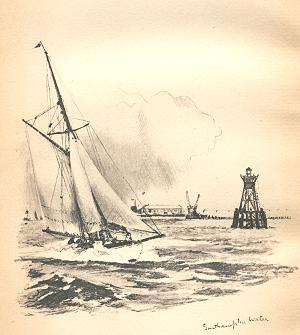
Rassembler en aussi peu de
temps une petite armada n'est pas chose aisée. Qu'à cela ne tienne, la Royal
Navy détache immédiatement 39 destroyers, des dragueurs de mines et quelques
autres bâtiments. Mais c'est insuffisant car la faible déclivité des plages
oblige les navires de fort tonnage à mouiller au large. Il faut dès lors
mobiliser des ferries, des chalutiers, des remorqueurs, des péniches, des yachts
et d'autres embarcations encore plus modestes, les désormais célèbres "little
ships". Il en vient 370 équipés tout au plus de deux mitrailleuses. Il faut
ensuite organiser cette noria. Entre Dunkerque et Douvres, la route la plus
directe est la route Z, longue de 60 km, mais elle est à portée des canons
allemands à la hauteur de Calais. La route Y évite cet inconvénient à ceci près
qu'elle met Dunkerque à 130 km de Douvres ; qui plus est, elle constitue un
terrain de chasse pour les vedettes lance-torpilles de la Kriegsmarine. La voie
la plus praticable est la route X, longue de 80 km ; elle ne sera toutefois
déminée que le 29 mai.
Malgré la vigilance de la RAF, le principal danger
vient des airs. Le 29 mai par exemple, 400 bombardiers, protégés par 180 stukas,
ont méthodiquement pilonné Dunkerque, mitraillant les plages sans omettre de
bombarder les bâtiments croisant au large. Ce jour-là, le bilan des pertes est
tellement lourd que l'Amirauté décide d'arrêter l'opération : au total, près de
250 embarcations sont envoyées par le fond ; des vedettes lance-torpilles ont
raison de deux torpilleurs français modernes, le Jaguar et le Sirocco.
Heureusement que le plafond des nuages, souvent très bas,et les fumées des
incendies gênent la Luftwaffe, laquelle ne peut sortir ses escadrilles que les
27, 29 mai et 1er juin.
Les opérations de rembarquement sont incommodes. Il y a trop
d'hommes et pas assez de bateaux. Pour s'échapper, il faut soit être accepté à
bord d'un navire accostant au môle est du port (l'actuelle jetée est s'avance en
effet de 1 500 mètres dans la mer), soit rejoindre la plage et avancer en file
indienne jusqu'à une embarcation légère qui fait le va-et-vient entre le rivage
et le bâtiment au large. La machine s'est rodée ; le premier jour, 7 669 hommes
ont pu rejoindre un port allié, 17 804 le second, 47 310 le troisième, 53 823 le
quatrième. C'est inespéré !

Le 4 juin à 3 h 20, le Shikari, chargé à ras
bord de soldats, quitte le môle pour sa dernière rotation. à 10 h, l'armée
allemande investit Dunkerque.
En neuf jours, 338 226 combattants (dont 123
095 Français) ont pu être évacués sur une mer d'huile ; la Wehrmacht capture
quelque 35 000 soldats ; la quasi-totalité sont des Français dont la plupart
avaient participé aux combats d'arrière-garde.
L'évacuation de Dunkerque suscite
néanmoins pas mal d'aigreur chez les responsables français. Weygand et d'autres
feront notamment grief aux Anglais d'avoir fait échouer la contre-attaque sur
Arras. Les relations entre les Alliés, souvent assez confuses, avec des
difficultés de communication perceptibles à bien des échelons, seront désormais
placées sous le signe de la méfiance.
à Londres, on éprouve du soulagement et
de la gratitude : les combattants de Dunkerque sont traités en vainqueurs et non
en vaincus ; sur les quais de débarquement comme dans les gares, on leur fait
fête. Quand bien même Churchill prend soin de tempérer l'enthousiasme de son
peuple en soulignant que "les guerres ne se gagnent pas avec des évacuations"
aussi héroïques soient-elles, ces mots imprimés dans les colonnes du journal
américain "New York Times" au lendemain de l'opération Dynamo ont conservé toute
leur acuité : "Tant que l'on parlera anglais, le nom de Dunkerque sera prononcé
avec le plus grand respect."
Sources : "1939-1940, l'année terrible.
Dunkerque : sortir de la nasse" - Jean-Pierre Azéma, "Le Monde", 27 juillet
1989.
(Images
et
textes
-
sources
diverses
-
Internet)
|