|
Adam de la Halle, d'Arras écrivain poète médiale picard (1235-1288)
les
plus considérables des écrivains de l'époque

Babeuf, François
Noël (1760-1797), publiciste et révolutionnaire français
Né à Saint-Quentin
(Aisne), François Noël Babeuf est issu d'un milieu peu aisé. Géomètre de
formation,
il se familiarise avec les problèmes de la propriété en devenant
commissaire à terrier, c'est-à-dire tenancier d'un registre foncier de
seigneurie.
En 1787, il monte à Paris où il se fait connaître, au début de
la Révolution française, en défendant un plan de réformes fiscales porté à la
connaissance des politiques sous forme pétitionnaire. Quoique fondamentalement
révolutionnaire, Babeuf paie cette audace du premier de ses
emprisonnements.
Libéré, Babeuf devient administrateur du département de la
Somme. Au contact du terrain, il affine sa connaissance de l'économie, des
conditions de vie du peuple. Partisan d'une égalité économique et politique de
l'ensemble des citoyens, il prône la mise en commun des terres et des biens,
qu'il propose d'obtenir par abolition de l'héritage et confiscation de la
propriété individuelle. Il expose ses principes en payant de nouveau la rançon
carcérale (1794).
À sa libération, il fonde un journal, le Tribun du peuple ;
sous le pseudonyme de Gracchus Babeuf
Pour tenter de revenir à une révolution
pure, ils préparent, début 1796, la conjuration des Égaux afin de renverser le
Directoire et de faire appliquer la Constitution de 1793. Mais, arrêtés le 10
mai sur dénonciation, les conjurés sont jugés par une Haute Cour de justice.
Babeuf qui tente de se suicider la veille en se poignardant, il est
guillotinés le 27 mai 1797.

Jean Bart
Dunkerque 1650 - id.
1702
Marin français. ¾ Marin dans la flotte de Ruyter, corsaire puis officier
de la marine royale française, il remporta de nombreuses victoires contre les
Anglais et les Hollandais.

Branly Edouard
Amiens 1844 - Paris
1940
Physicien français. ¾ Il imagina, en 1890, le cohéreur à limaille,
premier détecteur d'ondes hertziennes.
Il conçut le principe de l'antenne
émettrice (1891) et fit des expériences de télécommande (1902).

Beaucourt Raymond (1867-1925) écrivain poète
naquit à
Vraignes-en-Vermandois,le village d'Hector ::::Crinon. Instituteur dans la
région parisienne,
il ne retrouvait son pays que durant les vacances. A
partir de 1908, il fit paraître en revue
(La Gazette de Péronne, La Revue
Septentrionale) poèmes picards assez académiques,
mais de bonne facture.
Son ouvre ne fut partiellement réunie qu'en 1975, cinquante ans après sa mort,
par René Debrie, sous le titre poèmes du Vermandois.

Blériot Louis
Le 25 juillet 1909, à bord du Blériot XI, son dernier prototype, il rallie
Calais à Douvres en 37 minutes. Il devient le premier homme à avoir traversé la
Manche par les airs. Cet exploit est salué par le monde entier

Bourgeois Emmanuel chanteur picard (1826-1877)
interprétait ses
chansons à l'occasion des noces, des banquets de village. Les paysans
appréciaient
beaucoup sa verve très souvent scatologique (un de ses
meilleurs textes s'appelle tout simplement El Crote).
Dans Corne o-z ét 'rchu
par ës' fame, il aborde un thème presque inévitable de la littérature
picarde
de la femme qui eng...uirlande son mari rentrant plus ou moins ivre
du cabaret. Mais, contrairement à la plupart des auteurs qui ont traité ce
thème, Bourgeois prend le parti de l'épouse...

Carion Henri écrivain
(alias Jérôme Pleum' coq)
de Cambrai de se situe franchement à droite:
c'est en légitimiste qu'il attaque Louis-Philippe.
L'ensemble de ses
Epistoles kaimberlottes paraît en 1839

Crinon Hector écrivain picard
(1807-1870
naquit dans une famille de petits agriculteurs à Vraignes-en-
Vermandois
(entre Péronne et Saint-Quentin). après avoir écrit vers 1830
des chansons révolutionnaires (perdues), change de camp et, dans sa
première Satire picarde, en 1851, il dénonce les "partageux"
(socialistes et
communistes).puis La "main à plume" et la "main à charrue"*
Lui-même
restera un paysan toute sa vie, composant ses poèmes en poussant la charrue, ce
qui
peut-être leur a donné cette vigueur, cette force rythmique étonnantes,
qui font des Satires picardes
(1863) l'ouvre majeure de notre
littérature. Crinon ne put faire d'études; il se forma tout seul, par la
lecture et par la méditation. Ce grand écrivain était un véritable
autodidacte.
Il eut une vie rude et malheureuse. Il fut frappé de paralysie
vers 1860. Pourtant, il ne cessa jamais de faire front. Il nous donne une
grande leçon de droiture et de courage. Il nous laisse aussi un témoignage de
grande valeur sur la vie des campagnes au milieu du XIxe
siècle.

David Edouard poète écrivain en picard (1863-1932), enfant de
Saint-Leu, a Amiens fut mis au travail dès l'âge de sept ans.
Par la suite,
il devint pourtant typographe, puis gérant d'une imprimerie.
Il publie en
1891 El Bataye ed Quériù, avec comme personnage principal le fameux "cabotàn"
Lafleur,
héros tonitruant et soiffard du petit peuple amiénois ; en 1897,
Chés lazars, recueil de poèmes consacré aux déshérités de Saint-Leu; et bien
d'autres livres, jusqu'à L'Oeuvre de l'Eglise Cathédrale d'Amiens (1929).
El
Néssainche ed l'Infant Jézu (1905) est une comédie de Noël dans laquelle on voit
Lafleur venir en aide à la Sainte Famille! David a été le grand poète
d'Amiens, où on l'appelait familièrement "Thiot Douaird" (Petit Edouard), mais
sa notoriété n'a guère dépassé les limites de la ville; ce qui lui a valut
etre en quelque sorte le "Mistral de la Picardie", il n'a pas su faire de
son dialecte, contrairement au félibre, une véritable langue littéraire,
originale et autonome. -Il n'a pas su sortir de l'ombre du
français

de Hauteclocque Philippe dit Leclerc
Belloy-Saint-Léonard
1902 - près de Colomb-Béchar 1947
Maréchal de France

de Gaulle
Charles
Lille 1890 - Colombey-les-Deux-Églises 1970
Général et homme
politique français.
Rappelé au pouvoir à la faveur de la crise algérienne
(mai 1958), il fait approuver une nouvelle Constitution, qui fonde la Ve
République. Président de la République (1959)démissionne (28 avril 1969).

Delambre Jean-Baptiste, chevalier astronome et géodésien
Amiens 1749 - Paris 1822
Après l'instauration du système métrique, il
mesura, avec P. Méchain, l'arc de méridien compris entre
Dunkerque et
Barcelone (1792 - 1799) pour déterminer l'étalon de longueur. Directeur de
l'Observatoire de Paris de 1804 à sa mort, il a laissé une Histoire de
l'astronomie

:Denis Théophile (1829-1908), de Douai, ne commença à
écrire en picard que très tard, alors que Watteeuw et Mousseron, pourtant
bien plus jeunes que lui, étaient déjà des célébrités. Ses Petits Tableaux
Rustiques (en vers) parurent de 1905 à 1907 à Cayeux, où il s'était retiré,
après une vie passée au service des sourds-muets. Oeuvre considérable,
variée, pleine de mouvement, de couleur, mais aussi d'émotion...
Desbordes-Valmore Marceline, de Douai (1786-1859), est un grand
poète français, admiré de Baudelaire, Rimbaud et Verlaine. Elle n'a écrit
que trois poèmes en picard, dont un Dialogue entre une fille qui veut se marier
et sa mère, qui la prévient que le mariage n'a pas que de bons
côtés..

Desrousseaux Alexandre (1820-1872)
Alexandre Desrousseaux est né dans la courée du Quartier
Saint Sauveur à Lille en 1820.
De son père à la fois passementier et violoniste, il
hérite de la passion de la musique. Dès 18 ans, il compose et chante dans les
rues et dans les cabarets. Pour 12 francs, il publie sa première feuille de
pasquilles sur laquelle on trouve " Le marchand de chansons ", " Clistorelle ",
" Le mariage de Saint Sauveur " et " Min p'tit amant ". C'est un succès.
Après son mariage en 1846, il continue de composer.
Deux ans après, il réunit toutes ses chansons dans un recueil qui connaît un
grand succès commercial. La même année, il quitte son emploi au Mont-de-piété
pour aller travailler à l'Hôtel de Ville. Il finit sa carrière comme préposé
chef des octrois de Lille.
L'évolution de sa carrière ne l'a jamais empêché de
chanter la vie humble des ouvriers, ses moments de désespoir comme ses moments
de joie.
De toutes ses ouvres, la plus célèbre continue encore
aujourd'hui d'être chantée, c'est la " Canchon dormoire ", le " P'tit Quinquin
". C'est une berceuse créée en 1853, écrite en patois lillois.

Dorgelès, Roland (1885-1973), romancier
français, auteur notamment des Croix de bois.
Né à Amiens, Roland Lécavelé,
dit Roland Dorgelès fut élève de l'École des beaux-arts. Devenu journaliste, il
fréquenta le Montmartre littéraire et artistique. Lorsqu'en 1914 éclata la
Première Guerre mondiale, il s'engagea dans l'infanterie et fut blessé au
combat. C'est à partir de cette expérience qu'il publia son premier livre en
1917, la Machine à finir la guerre. Il raconta encore la vie des tranchées dans
le roman qui l'a rendu célèbre, les Croix de bois (1919).
Roman réaliste, les
Croix de bois évoquent la vie quotidienne des poilus et leur face-à-face avec la
mort. Humour et tragique caractérisent ce tableau qui figure parmi les plus
représentatifs de la Grande Guerre. À défaut du prix Goncourt, décerné cette
année-là au roman À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust,
l'ouvrage obtint le prix Femina-Vie heureuse. Dorgelès en donna une suite, le
Cabaret de la Belle Femme (1919), mais il voua principalement son talent
littéraire à la passion de sa jeunesse, Montmartre. Des romans (les Veillées du
lapin agile, 1920), et des essais (le Château des brouillards, 1932 ; Vive la
liberté !, 1937 ; Bouquet de Bohème, 1947 ; Au beau temps de la butte, 1963)
l'évoquent affectueusement.
S'il écrivit à nouveau sur la guerre (Retour au
front, 1940) et sur la vie pendant l'Occupation (Carte d'identité, 1945), Roland
Dorgelès composa également plusieurs récits de voyage, parmi lesquels Sur la
route mandarine (1925), et se fit moraliste à la fin de sa carrière littéraire
avec, entre autres, À bas l'argent ! (1966) et Lettre ouverte à un milliardaire
(1967). Membre de l'Académie Goncourt à partir de 1929, il l'a présidée à partir
de 1955.

Jean
de
la
Fontaine
De petite noblesse, Jean naît le 8 juillet 1621 puis est baptisé
probablement le même jour à Château-Thierry en Champagne où son père, Charles,
exerçe la charge de "maître triennal des eaux et forêts" du duché de Chaûry. Il
passe toute son enfance dans cette province, un milieu rural et champêtre dont,
dit-on, son ouvre porte la marque. Son père, également Maître des Chasses, avait
épousé en 1617 une veuve de bonne maison poitevine, Françoise Pidoux.
Les
études de La Fontaine restent mal connues. Probablement les commence-t-il vers
1630, au collège de Château-Thierry, établissement réputé. Peu enclin à la vie
active et aux affaires, sa famille décide de l'envoyer après sa troisième, vers
1635, les achevées dans un collège parisien.
A Paris, il y suit des
études de théologie. Il est alors âgé de 19 ans. L'Eglise, premier état du
royaume, devrait lui assurer la sécurité. Cependant, pas décidé à respecter la
discipline monastique de la Congrégation de l'Oratoire où il reste un peu plus
d'une année, la perspective de devenir prêtre ne l'enchante plus. Seule la
littérature semble vraiment l'intéresser.
Des études faciles de Droit et
l'acquisition d'un diplôme de licencié en Droit pour 20 écus, lui donnent le
titre d'"avocat en la cour de Parlement". Il s'installe à Paris en 1646 où il
mène une vie dissipée dans les salles de jeux et les cabarets. Il y fréquente
Tallemant des Réaux. Il fait partie d'une petite académie littéraire et amicale
dite la "table ronde". Ces "Palatins" sont Pellison, Furetière, Maucroix,
Charpentier, Cassandre. Cette académie littéraire qui lui offre l'occasion de
lire beaucoup, poètes, philosophes grecs et latins, et surtout Malherbe qui lui
donne le goût des beaux vers.
Le 10 novembre 1647, sous la pression
paternelle il épouse Marie Héricard de la Ferté Milon (14 ans) qui lui apporte
une dot de trente mille livres et des immeuble pour une valeur de douze mille
livres. Le 30 octobre 1653, Marie lui donnera un fils, Charles, qu'il
délaissera plus tard. Auparavant, en 1652, il achète une charge de maître
particulier triennal des eaux et forêts à Château-Thierry pour une valeur de
douze mille livres. Plus tard, en 1658, il hérite des deux charges de son père
décédé.
Enfin, en 1654, Il décida de se consacrer à la littérature et
ouvre un salon littéraire à Paris où il vit avec son épouse. Poussé par quelques
amis, il se lance sans succès dans une adaptation en vers d'une comédie
(L'eunuque) immitée de Térence. L'accumulation des dettes, les faibles revenus
de ses charges ainsi que de lourds droits de succession l'obligent à se chercher
un protecteur.
La publication du poème héroïque l'Adonis (1658) imité d'Ovide
lui vaut l'admiration et la protection de Fouquet (1659) le surintendant du
jeune roi Louis XIV. il vit à sa cour à Vaux-le-Vicomte. La Fontaine s'engage à
"pensionner" Fouquet en vers. Cette rencontre n'est cependant pas des plus
heureuse, puisque le 5 septembre 1661, alors qu'il était en train de composer le
Songe de Vaux, Fouquet est disgracié, arrêté à Nantes et enfermé par le
roi.
La Fontaine est donc privé de son protecteur, et poursuivi par la
disgrâce royale pour sa fidélité (Ode au roi pour M. Fouquet, 1662). Il juge
alors prudent de s'éloigner de la capitale et part un temps dans le Limousin
(vraisemblablement à Limoges).
L'affaire Fouquet s'étant calmée, il
retourne dans sa ville natale en 1664, et pour vivre, se place sous la
protection du duc de Bouillon (seigneur de Château-Thierry). Par ses Contes
(1665-66-71) frivoles et libertins voire paillards inspirés notamment
d'Aristote, il divertit la duchesse de Bouillon nièce de Mazarin. Pour l'époque,
ces écrits font scandales et ne se vendent pas.
Il partage alors son temps
entre Paris et Château-Thierry. Ses aventures extra-conjugales ont raison de son
mariage. Il se sépare de sa femme et de son fils.
Privé de ressources, il
revient à Paris et peut-être par l'entremise de la duchesse de Bouillon, il
devient "gentilhomme servant" de Marguerite de Lorraine. Il sert la duchesse
douairière d'Orléans, veuve de Gaston d'Orléans, au palais du Luxembourg (le
Sénat actuel) pour deux cents livres par an. Charge des plus modeste, mais qui
lui vaut d'être anobli. Il est l'un des neuf officiers qui président tour à tour
au service de la table.
Cependant, il ne vit pas au Luxembourg où la vie est
austère et dévote. Il loge quai des Augustins chez le magistrat Jacques Jannart,
oncle de son ex-épouse, ancien collaborateur de Fouquet.
Heureux d'être
à Paris, il fréquente dans les cercles littéraires les écrivains les plus
renommés de son temps : La Fayette, Sévigné, Boileau, Molière, Racine, Perrault,
La Rochefoucauld.
Il cherche en vain à obtenir une pension du roi, mais
Colbert, nouveau surintendant et ennemi de Fouquet s'arrange pour le garder
éloigné de la cour.
Soucieux et conscient du poids de ses écrits frivoles, il
pense se faire pardonner en publiant en 1668 son premier recueil de Fables
(livres I à VI des éditions modernes). Rien n'y fait.
En 1672, à la mort de
la duchesse douairière d'Orléans, il s'installe rue Neuve-des-Petit-Champs chez
son amie Mme de La Sablière, femme très cultivée et issue d'une grande famille
de banquiers. Il y restera de 1673 à 1693 et y mènera une vie mondaine assez
brillante.
Cependant, la publication des nouveaux Contes ne plaisent pas au
roi et sont interdits. Pratiquement sans ressources, il en arrive à revendre ses
charges au Duc de Bouillon ainsi que la maison de Château-Thierry.
En 1678,
il fait paraître son deuxième recueil de Fables (livres VII à XI) et le dédie à
Mme de Montespan dans l'espoir de s'attirer sa protection. Enfin son talent
commence à être reconnu et les publications des fables circulent.
Encouragé
par Mme de La Sablière il se présente à l'Académie française. Le roi s'y oppose
pendant deux années à cause de sa réputation de libertin et de son amitié pour
Fouquet, mais il fini par être élu en 1683. Cette année, meurt Colbert.
En
1693 à la mort de Mme de La Sablière, désespéré et malade, il va chez son viel
ami le banquier d'Hervart qui l'héberge. Le 12 février 1693, il se repent de ses
"contes infâmes" devant une délégation de l'Académie et reçoit la communion. Il
publie en septembre 1693 le livre XII des Fables.
Les deux dernières années
de sa vie, malade, il renonce à la vie mondaine, renie ses Contes et ne publie
plus rien qui soit contraire à la religion et la vertu. Il se consacre à la
méditation et hante les églises où en priant il tente de faire face à sa peur de
l'enfer. C'est dans cet état d'esprit qu'il meurt le 13 avril 1695. Il a alors
soixante-quatorze ans.
En procédant à sa toilette mortuaire, on trouve sur
lui un cilice (large ceinture de crin de chèvre portée sur la peau par
pénitence).
La Fontaine est enterré le 14 avril au cimetière des
Saints-innocents. Par suite d'une erreur commise sur ce point par d'Olivet dans
l'Histoire de l'Académie, les commissaires de la Convention exhumeront en 1792,
pour leur éléver un mausolée, des ossements anonymes dans un autre cimetière.

Lamarck,
Jean-Baptiste de (1744-1829), botaniste et zoologiste français, spécialiste des
invertébrés, qui formula l'une des premières théories de
l'évolution.
Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck, naquit à
Bazentin-le-Petit, en Picardie. Envoyé à l'école des jésuites d'Amiens, il y
reçut une éducation classique jusqu'au décès de son père en 1759. Il rejoignit
ensuite l'armée et commença à étudier les plantes. Neuf ans plus tard, il
renonça au métier des armes pour se consacrer à l'étude de la médecine, à Paris.
Il s'intéressa aussi à l'histoire naturelle, à la météorologie, à la chimie et
aux collections de coquillages. Il réunit ses observations botaniques dans un
premier ouvrage que le naturaliste Buffon fit publier en 1778 sous le titre de
la Flore française. C'est grâce à cette flore et à son amitié avec Buffon que
Lamarck fut élu, l'année suivante, à l'Académie des sciences. Il devint
botaniste du Roi en 1781. Lorsque le Jardin du Roi fut réorganisé en 1793, il
participa à la fondation du nouveau Muséum national d'histoire naturelle. Il
abandonna ensuite la botanique et devint professeur de zoologie des invertébrés,
un nouveau domaine consacré aux insectes et aux vers. Il publia un
impressionnant ouvrage en sept volumes, Histoire naturelle des animaux sans
vertèbres (1815-1822).

Lebesgue Philéas poète picard
naquit dans le pays de Bray
picard, le 26 novembre 1869. et décède le 11 octobre 1958 à La-Neuville-Vault
Ses parents tenaient une ferme et ainsi son enfance se passa dans les bois,
les vallées,
au sein d'une famille unie et, aimait-il à le
rappeler avec un père qui "nourrissait une véritable passion pour les
beautés de la nature". Polyglotte, grand voyageur, Phileas Lebesque était lié
aux poètes symbolistes. Il fut chroniqueur au "Mercure de France" et grand
druide du collège Bardique des Gaules. Il est l'auteur de quarante-huit
recueils de poésies et de chansons, de poètes bretons

La Barre (1765 -
1766)
Affaire judiciaire dont la victime fut François Jean Le Febvre,
chevalier de La Barre, gentilhomme français (Férolles, près de
Brie-Comte-Robert, 1745 - Abbeville 1766). ¾ Accusé d'impiété (il aurait mutilé
un crucifix et ne se serait pas découvert au passage d'une procession du
Saint-Sacrement), il fut décapité. Voltaire réclama sa réhabilitation, décrétée
par la Convention en 1793

Mac Orlan, Pierre (1882-1970), écrivain
français, dont l'ouvre est une évocation du monde des marges.
Né à Péronne
(80), Pierre Dumarchey, dit Pierre Mac Orlan, vit son enfance et sa jeunesse -
selon une légende qu'il a tissée lui-même plus tard - dans la misère,
travaillant de port en port. Peintre, puis journaliste il s'intègre au petit
cercle d'intimes de Max Jacob et de Guillaume Apollinaire, au Bateau-Lavoir, à
Montmartre. Ses premières ouvres cultivent l'insolite (la Maison du retour
écourant,1912 ; le Rire jaune, 1914). Il publie aussi des souvenirs de ses
débuts difficiles (le Petit Manuel du parfait aventurier, 1918).Viennent
ensuite un récit fantastique (le Nègre Léonard et Maître Jean Mullin, 1920), des
romans qui mettent en scène l'univers cosmopolite, marginal et misérable
qu'il a bien connu (le Chant de l'équipage, 1918 ; la Bandera, 1931), qui mêlent
le réel et l'imaginaire (Marguerite de la nuit, 1925 ; le Quai des brumes,1927 ;
l'Ancre de miséricorde, 1941), qui détournent la tradition du roman policier
vers l'horreur, l'inquiétant ou le burlesque (la Tradition de minuit, 1930 ;
Quartier réservé, 1932), ou encore des récits purement imaginaires (Sous la
lumière froide, 1945).

MANESSIER Alfred
Saint-Ouen, Somme, 1911 -
Orléans 1993
Peintre français. ¾ Coloriste vibrant, il a notamment traduit en
peintures abstraites les grands thèmes de l'art sacré.

| 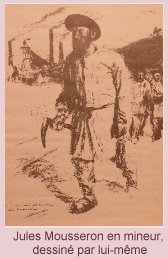
|
|
Mousseron
Jules (1868-1943) poète écrivain né à Denain, dans le Hainaut travailla à
la mine de 1880 il a douze ans) à 1926. A quatorze ans, il est soutien de
famille. Néanmoins, il renonce à se cultiver et, en 1897, il publie son
premier livre de poésies patoises, Fleurs d'en Il donnera plus de mille lectures
publiques, attirant un public toujours très nombreux. )n fit de lui le
mineur modèle; on fabriquait des pipes, des assiettes à son effigie. Toute
ouvre est consacrée aux houillères, aussi bien au travail au
fond qu'aux
loisirs et aux sirs des ouvriers. Elle constitue à ce titre un document
extraordinaire.
En 1895, Mousseron lança le fameux Cafougnète, dans lequel
tous les chtimis ont reconnu leur "type". Ce qu'on peut reprocher à
Mousseron -comme à beaucoup d'autres écrivains patois-, c'est de n'avoir
pas senti que le picard était, ou pouvait être, une langue. Il a trop ;roché
son patois du français, syntaxe et même vocabulaire... Mais ce fut sans
doute la condition (et la rançon) de sa gloire, car le recours à cette
langue édulcorée lui permet l'être compris de tous.
|

Noiret Philippe acteur de cinéma né le 01/10/1930 à Lille
Le berceau de la famille Noiret,
toutes branches confondues, est bien implanté
en Picardie, entre Abbeville
et Amiens. Ses origines maternelles sont partagées
entre la province de
Namur et la Flandre occidentale en Belgique. L'union entre
les familles
Noiret et Heirmann se fit en 1923.

Parmentier Antoine Augustin
Montdidier 1737 - Paris 1813
Pharmacien militaire français. ¾ Il
vulgarisa en France la culture de la pomme de terre.

Paris Edouard
l'Amiénois écrivain picard
vérificateur des poids et mesures, publie à
Londres en 1863,,
S'Sint Evanjil sIon Sin Matiu, ouvre importante, ouvre de
pionnier. En effet:
1) pour la première fois, un grand texte de la
littérature universelle est traduit en picard.
2) pour la première fois
également, on a cherché à doter notre langue régionale d'une
orthographe
particulière, spécifique, au lieu de recourir à l'orthographe "petit frère" (qui
imite celle du français). La méthode d'Edouard Paris est très rigoureuse: "le
picard, tel qu'aujourd'hui on le parle à Amiens, renferme 36 sons radicaux
ou effets phoniques simples et élémentaires. Pour représenter ces 36 sons,
nous employons 36 signes auxquels nous convenons de donner une valeur
invariable de prononciation".

Piat Jean né le 23/09/1924 à Lannoy
(nord) Artiste dramatique ,écrivain

Pinguet,
Philippe-Louis journaliste
de Saint-Quentin, qui signe Gosseu (le moqueur), fait entendre la voix
des révolutionnaires (Anciennes et Nouvelles Lettres picardes,
1846.

de Robespierre Maximilien
Arras 1758 - Paris 1794
Homme
politique français. ¾ De petite noblesse, orphelin, il est d'abord avocat à
Arras. Député aux États généraux, orateur influent puis principal animateur du
club des Jacobins, surnommé « l'Incorruptible », il s'oppose fermement à la
guerre. Membre de la Commune après l'insurrection du 10 août 1792, puis député à
la Convention, il devient le chef des Montagnards. Hostile aux Girondins, il
provoque leur chute (mai-juin 1793). Entré au Comité de salut public (juillet),
il est l'âme de la dictature, affirmant que le ressort de la démocratie est à la
fois terreur et vertu ; il élimine les hébertistes (mars 1794) et les indulgents
menés par Danton (avril), puis inaugure la Grande Terreur (juin). Enfin, il
impose le culte de l'Être suprême (8 juin). Mais une coalition allant des
membres du Comité de salut public aux conventionnels modérés décide le 9
thermidor an II (27 juillet) de mettre fin aux excès de Robespierre, qui est
guillotiné le 10 thermidor avec ses amis Saint-Just et Couthon

Albert
SAMAIN
né 03 à Lille 1836
il écrivit de nombreux recueils de poèmes
aussi remarquables que renommés , parmi ceux-ci Au Jardin de l'Infante , Aux
Flancs du Vase, ou encore Le Chariot d'Or. On dit de Samain que sa poésie est
héritière de Baudelaire par l'intérêt de l'artiste pour l'univers des
correspondances. Il est mort, de la tuberculose, à Magny-les-Hameaux en
1900

Seurvat Louis (1858-1932)écrivain picard,
n'a commencé à parler
et à écrire le picard que très tard. Il " en est expliqué lui-même: "Séduit par
l'originalité et le pittoresque des expressions, la variété des cadences,
l'harmonie imitative, la bonhomie railleuse et l'énergie du dialecte
picard, que j'entends parler autour de moi surtout depuis que les circonstances
m'ont :conduit en pleine Picardie, j'ai appris presque inconsciemment
d'abord, subissant l'influence d'un milieu qui me plut
(Ailly-sur-Noye
étant devenu mon pays d'adoption), et volontairement ensuite
C..) à parler LE PICARD..."
Ses premières chansons, en 1902 et 1903,
obtinrent un succès considérable, en particulier L'Catédrale d'Amièns et ln
'rvnant d' ché Barnum. Il a écrit aussi de nombreux contes en vers, comme
L'Soupe a cayeus. Seurvat est le type accompli du poète patoisant. Il
exploite la veine paysanne, souvent 3 catologique, jusqu'au bout, avec
beaucoup de malice (car il est très conscient de ce qu'il :ait) et une grande
efficacité.

CHARLES TELLIER
Amiens 1828 - Paris 1913
Ingénieur
français. ¾ Il aménagea le Frigorifique, premier navire qui réussit le transport
à longue distance de viandes conservées par ses procédés de refroidissement
(1876).

Jules Verne naquit en 1828 à Nantes il arrive a Amiens en
1870 après avoir épouser Honorine Morel, une jeune veuve amiénoise, mère de deux
petites filles. Le mariage a lieu à Paris où va résider le couple dans un
premier temps. Mais il séjourne fréquemment à Amiens où sont restées les filles
d'Honorine .
En 1882, la famille Verne emménage au 2 de la rue Charles
Dubois. La maison est vaste et les réceptions bourgeoises se multiplient:
chaque mercredi, on se réunit chez les Verne pour écouter des monologues, des
romances, des concerts.
En 1886, il est blessé à la jambe en tentant de
désarmer son neveu, un jeune déséquilibré, qui le menaçait d'un revolver. Il
boitera ensuite toute a vie.
En 1886, cas unique chez les écrivains français,
il se présente au Conseil Municipal, sur la liste du maire radical Frédéric
Petit. Il est élu et s'y montre très actif et intéressé par les réalités
administratives de la gestion d'une ville puisqu'il fera quatre mandats
Sur
les 62 romans de la série des "voyages extraordinaires", il en écrira 55 à
Amiens, au Crotoy, et au Tréport où il a son bateau.
Contrairement à la
légende qui dit que Jules Verne a très peu voyagé, le virus du voyage l'a
toujours possédé. Il aura de nombreux bateaux dont le dernier, le Saint Michel
III, est un yacht somptueux. Avec lui, il fait de belles croisières vers le
Maroc, l'Irlande, l'Ecosse, la Norvège, la Méditerranée. Il s'embarquera aussi
pour les Etats Unis.
En 1900, il est atteint de cataracte. Sa maison de la
rue Charles Dubois lui paraît trop grande et il retourne boulevard de
Longueville où il mourra le 24 mars 1905, des suites d'une attaque de
diabète.
5000 personnes, dont de nombreuses personnalités venues de l'Europe
entière, assisteront à ses obsèques. Il repose au cimetière de la Madeleine. La
tombe, magnifique, est signée A. Roze.
Amiens la Picardie n'apparaît pas
dans l'ouvre de Jules Verne, mais un roman, publié par son fils en 1910, « Le
secret de Wilhelm Storitz » se déroule dans une ville imaginaire. L'auteur en
fait une description détaillée et l'observateur avisé y reconnaîtra Amiens, sa
cathédrale et ses boulevards. Et la maison du docteur Roderich est celle de la
famille Verne, avec sa tour, ses grands salons et sa
véranda

Watteeuw Jules (1849-1947), chansonnier de Tourcoing,
fonda en 1882 La Brouette latique et divertissante, hebdomadaire rédigé
par lui seul et entièrement en patois. La luette atteignit le
tirage aujourd'hui incroyable de dix mille exemplaires et vécut vingtIl ans
(jusqu'en 1907). Watteeuw, surnommé le "brouteu", se produisit environ quatre
mille fois en public. Sa popularité était si grande que, pour son
cinquantième anniversaire, ses concitoyens lui firent une maison,
entièrement décorée de sculptures et de fresques inspirées par son
oeuvre!
Il mourut presque centenaire, en 1947.

|