|
Accusations portées à l'encontre de Jeanne Delecluse
« Dans le procès intenté à
Jeanne Delecluse, femme de Nicolas Fourmantel,
tous deux de Merville et qui
dura, avec interrogatoires contradictoires
et plusieurs applications de la
torture, du 27 décembre 1658 au 26
février 1659, on trouve juxtaposés très
nettement les deux points de vue.
Selon le premier, d'ordre laïque, Jeanne
est accusée par ses voisins
d'avoir fait des maléfices ; mais ces témoignages
parurent peu probants
et on l'acquitta de ce chef ; selon le second, elle
renia le baptême,
profana l'hostie, assista au banquet des sorcières, eut
commerce charnel
avec un ou plusieurs diables, reçut leur marque, etc. et de
ce chef fut
décapitée puis brûlée et ses biens furent confisqués. La
procédure montre
bien l'hésitation des juges, mais leur inaptitude à résister
au courant
d'idées imposé par les inquisiteurs. Il s'agissait de faire avouer
sur
deuxième chef seulement ; et ce n'est que pour lui, non pour un aveu
de
maléfices, qu'on appliqua la question. Les réponses dangereuses
étaient
imposées par la forme même des demandes. Dans cette section de
la
procédure on ne trouve par suite aucun détail régional, ni
spécifiquement
folklorique.
Mais l'autre partie vaut la peine d'être
citée au moins partiellement.
Jeanne Delecluse était accusée :
1°
D'avoir éveillé un jeune homme en le frappant sur l'épaule gauche,
disant
qu'il lui fallait le sac de blé sur il était couché ; le jeune
homme se
sentit aussitôt mal à l'aise, déclara qu'il était maléficié, et
mourut peu
après ;
2° D'avoir maléficié la femme du cordonnier qui prenait mesure
d'une
paire de souliers à l'accusée en lui faisant avoir mal au bras ; la
femme
du cordonnier n'a pu en être guérie que par des exorcismes fréquents
et
assidus pour avoir pris cette mesure au lieu de son mari ;
3°
D'avoir fait mourir un coq qu'on n'avait pas voulu lui vendre ; puis
le chien
de la cour devenu malade et est mort à son tour, puis la
déposante
s'apercevant que ses poules étaient accidentées du même mal et
s'imaginant
que c'était par le sortilège, a employé l'assistance des
pères capucins pour
faire exorciser ses poules et poulets, comme aussi le
reste de ses bestiaux,
voire même les étables, chambres et autres
édifices de la maison ; ensuite de
quoi lesdits poulets ont été guéris et
on ne s'est plus de rien aperçu."
(Ibidem, pp.515-516)*. Mais dans
l'intervalle un poulain était mort (ibidem,
p.513)*.
4° D'avoir, ayant trouvé des bêtes venimeuses dans les
entrailles d'une
de ses propres vaches, laissé son chien les manger au lieu
de les porter
à exorciser par les pères capucins comme elle avait dit qu'elle
ferait.
L'un des témoins déclare avoir vu ces bêtes déjà déposées dans un pot
:
une avait la forme d'un crapaud, une autre la forme d'une couleuvre
avec
deux têtes et la troisième avait le groin d'un cochon "
(ibidem,
p.517)*. Le déposant avait offert de brûler ces bêtes dans son
jardin ;
mais l'accusée avait dit que dans ce cas toutes leurs autres
vaches
viendraient à mourir, et qu'il valait mieux les porter aux
capucins.
5° D'avoir maléficié une voisine qui était venue lui acheter de
la crème
bouillie et, l'ayant mangée, se serait sentie atteinte de maux
d'estomac
et de ventre "qui auraient continué jusqu'à ce qu'ayant été avertie
que
le meilleur moyen de se guérir des maladies des sorcières était
de
prendre deux fois de leurs objets", lui a acheté de nouveau de la
crème
bouillie ; et cette fois après l'avoir mangée, elle aurait été
guérie.
Ce procédé de guérison par redoublement paraît assez rare, du
moins je ne
le vois pas signalé ailleurs dans le Nord. La transmission du mal
par contact est bien visible dans les deux premières accusations on
remarquera aussi la puissance contraire attribuée aux capucins, croyance assez
répandue dans toute la France et en Belgique ; et enfin que Jeanne Delecluse
semble avoir cru elle-même à la sorcellerie au moins autant que ses
voisins.
La procédure ajoute que déjà sa mère avait maléficié et fait
mourir une
vache. Mais Sur tous les points de sorcellerie, l'accusée persista
dans ses
dénégations, même après une première question préalable.
C'est
sur le reste seulement (hérésie) qu'on réussit à la faire avouer. Les juges de
Béthune confirmèrent l'arrêt des échevins de Merville.
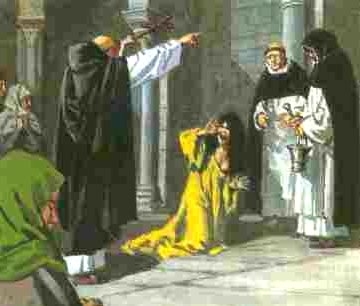
Dans les détails
de ce procès il y en a un qui n'est intelligible que si
l'on se rappelle la
croyance très répandue au Moyen-Age que certaines
maladies, et
principalement la rage, étaient dues à l'existence dans
l'estomac ou les
intestins d1un animal, de vers ou de serpents. A propos
des procédés de
guérison de la rage, en Allemagne et dans les pays de
langue allemande,
Alfred Martin rappelle que Pline croyait la rage des
chiens due à ce qu'ils
avaient un ver dans la langue ; de son Histoire
Naturelle cette croyance a
passé dans un grand nombre de traités de l'Ars
Venatoria du Moyen-Age, puis
dans des ordonnances municipales et des
codes coutumiers locaux (Martin,
Tollwutbe-koempfung, pp. 53-57). Une
opinion aussi répandue, qui subsiste
dans les campagnes françaises, est
que parfois la rage est due à un ver situé
au bout de la queue des chiens
et des chats. Mais souvent aussi on croyait la
cause vivante du mal
localisée dans le ventre.
Ainsi l'abbé Huyghebaert cite un
texte flamand date de l'an 1134 et
émanant de l'autorité ecclésiastique de
Malines, ou il est dit qu'un
"loup enragé qui portait dans son corps trois
serpents vivants a quitte
son repaire traditionnel et parcourt les champs"...
Finalement quatre
hommes courageux parvinrent à capturer ce loup ; quand on
l'a ouvert,
il a donné par les serpents la preuve de sa méchanceté.
On pourrait donc déduire de ces documents, et d'autres
moins précis, qu'en Flandre française subsistait la croyance que tout
animal contenant des serpents, ou autres annelés et reptiles, était voué à
la rage.
*(Ibidem
:
"Religion" de Louis de Baecker) Les procès
verbaux sont
conservés aux archives de Bailleul.
|